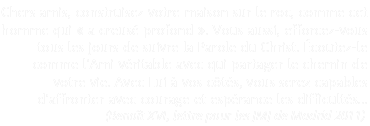homélie du 2e dimanche de Pâques, 27 avril 2025
Les événements racontés dans cet évangile ouvrent les temps nouveaux. On passe de la vie publique de Jésus à la vie de l’Église. Pendant quelques semaines Jésus va initier ses disciples, les 12 et le cercle plus large, à la vie nouvelle. Puis il y aura l’Ascension, à partir de laquelle le contact de Jésus avec ce monde ne sera plus visuel, auditif ou tactile : ce sera un contact plus intérieur, par la foi. Jésus initie à ce mouvement à travers ce qui arrive à Thomas.
Parmi les éléments de cette vie nouvelle il y a le rassemblement le premier jour de la semaine. Saint Jean prend soin de le noter. Et 8 jours plus tard. Jésus initie un mouvement que nous continuons jusqu’à maintenant : le rassemblement dominical autour du Christ. Ce n’est pas un précepte écrit quelque part dans la Bible, mais la Tradition vivante que les premiers chrétiens ont transmise à l’intérieur de l’Église.
La Tradition ? Quel est sa pertinence ? Ne serait-ce pas des coutumes inventées par les hommes ? Des lourdeurs et ajouts à l’Écriture, comme on l’entend parfois ? Bien sûr, il peut y avoir des éléments comme cela, et sans cesse il faut purifier le style de vie de l’Église pour qu’il redevienne plus authentique. Mais plus profondément, il y a un style de vie vraimen chrétien qui n’a pas besoin d’être écrit pour être transmis. Saint Paul en parlait déjà aux habitants de Thessalonique au début des années ’50 : « gardez fermement les traditions que vous avez apprises de nous, de vive voix ou par lettre. » (2 Th 2,15)
Comment sait-on si tel élément de la Tradition n’est pas une invention humaine tardive ? Regardons dans quelle mesure il est tenu en des temps fort anciens par des Églises fort éloignées les unes des autres. À une époque où l’autorité de l’Église n’était pas aussi centralisée qu’avec la papauté depuis le Moyen Âge, une telle unanimité ne peut venir que d’une pratique de l’Église primitive.
Ainsi en est-il du rassemblement du dimanche. Partout, dans les communautés d’Italie, de Grèce, du proche-Orient, d’Égypte, d’Éthiopie, d’Inde, on observe le dimanche. Il en est de même de la vénération pour la Vierge Marie, ou de la prière pour les morts. Ces pratiques sont répandues dans les Églises anciennes aussi éloignées les unes des autres qu’elles soient. Elles ne peuvent provenir que de cette manière de vivre qu’ont adoptée les premiers chrétiens aux premiers temps de l’Église, ces traditions écrites ou transmises de vive voix dont parle saint Paul.
Du récit d’aujourd’hui nous apprenons aussi que Jésus dépose sur les apôtres sa paix. Et il les envoie ; les voilà envoyés comme Jésus fut envoyé par le Père. Il les envoie avec le don de l’Esprit Saint, qui leur donne son pouvoir de remettre les péchés.
Nous avons là la mission de l’Église : avancer avec la paix et la force du Christ, pour diffuser partout la réconciliation qu’il a acquise par le don de sa vie : une communion nouvelle avec Dieu est offerte aux hommes, l’intimité retrouvée par le pardon des péchés et la vie dans l’Esprit Saint.
Jésus transmet ainsi à son Église un pouvoir pour lequel il a donné sa vie. Rappelez-vous lors du pardon des péchés du paralytique, au début des évangiles. Beaucoup disent : « Qui est-il celui-là ? Il dit des blasphèmes ! Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? » (Lc 5,21) Mais Jésus a montré qu’il avait ce pouvoir, et maintenant il le donne à son Église.
Pourquoi l’Église, pourquoi l’institution, dont nous avons beaucoup parlé en ces jours ? Pour offrir aux hommes la réconciliation avec Dieu, l’occasion de vivre dans sa lumière, branchés sur son cœur, artisans d’un monde renouvelé. C’est la raison d’être de toutes les demandes de pardon que nous disons quand nous prions, et du sacrement de réconciliation qui vient fortifier tout cela. Bon dimanche de la miséricorde !