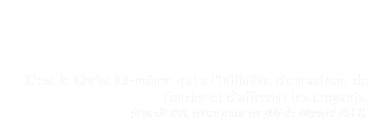Le premier bébé-médicament français est né cette semaine de 20111. Beaucoup s’en félicitent. Ce bébé a été choisi parmi plein d’autres au temps où il était un embryon de quelques cellules, choisi parce que ses gènes présentent des caractéristiques qui font de lui un donneur compatible pour soigner la maladie d’une autre personne.
La technique consiste à produire un bon nombre d’embryons, de pratiquer sur eux un « diagnostic pré-implantatoire » qui permet de voir lequel est sain et porte les caractéristiques d’un donneur compatible, et de n’implanter que celui qui a été choisi, les autres allant en quelque sorte à la poubelle.
consiste à produire un bon nombre d’embryons, de pratiquer sur eux un « diagnostic pré-implantatoire » qui permet de voir lequel est sain et porte les caractéristiques d’un donneur compatible, et de n’implanter que celui qui a été choisi, les autres allant en quelque sorte à la poubelle.
Faire naître des bébés médicament pose des tas de questions. Il y a celle du destin des autres embryons, qui sont des vies inaugurées, des vies d’êtres humains, vouées volontairement à la perte. Je reviendrai sur cela dans un autre article.
Il y a la question du choix de vie ou de mort : le diagnostic pré-implantatoire consiste à dire : « je t’examine pour savoir si tu peux vivre ou non. » Le garçon, la fille médicament devront se dire : on a choisi de me laisser vivre et de ne pas laisser vivre mes frères, mes sœurs qui ne convenaient pas.
Il y a la question du choix de vie en vue d’une utilité. Personne n’a demandé à naître. Beaucoup ont été voulu, d’autres non. Ceux qui découvrent qu’ils n’ont pas été voulus auront un traumatisme à surmonter mais pourront luter avec la conscience de devoir remporter une victoire sur le non-sens. Ce n’est pas le désir d’autres qui commence à donner du sens à leur vie, mais leur propre choix de vivre et d’affirmer cette vie, valeur en elle-même. Ceux qui sont nés en ayant été désirés semblent partir dans la vie sous de meilleurs auspices, mais ils auront un travail tout aussi difficile à faire pour s’approprier leur vie, pour ne pas être celui qui comble les désirs d’un père, d’une mère. Ceux qui sont nés parce qu’ils étaient nécessaires pour sauver un frère, une sœur, bientôt un oncle, un cousin, que pourront-ils se dire ? Bien des choses. Ils auront à surmonter un orgueil très particulier, dans un contexte où celui qu’ils sauvent leur sera infiniment redevable. Mais quand ils se poseront la question du sens de leur vie, ils ne pourront pas dire que leur vie vaut d’abord pour elle-même, car ce n’est pas ainsi qu’elle a été envisagée. Leur vie n’est pas issue d’une absence de projet ; elle n’est pas non plus issue d’un projet de vie pour elle-même ; elle vient d’un projet de vie pour autre chose que la vie en elle-même. C’est parce qu’ils pouvaient guérir ce parent qu’ils existent, choisis au milieu de quantité d’autres qui n’existent plus. Ils devront construire leur vie sur cet abîme : puis-je dire que j’existe pour moi-même ?2
Vous me direz : bien des gens doivent construire leur vie au-dessus d’un abîme. Oui, mais on dira quand-même que c’est un drame, on ne dira pas que c’est un bien, on ne s’en félicitera pas, on ne cherchera pas à l’institutionnaliser, au contraire on voudra éviter que cela puisse se reproduire. Occasionner un drame pour remédier à un drame, ce n’est pas sage, ce n’est pas juste, même si c’est utile. Alors, pendant combien de temps encore les faiseurs d’opinion vont-ils endormir notre conscience ? Quand dira-t-on : c’est assez ? C’est assez de réduire la vie à quelque chose sur lequel la revendication d’autonomie de l’individu a tous les pouvoirs !
1En Belgique cela fait longtemps, en 2005. Je ne me souviens même pas qu’on en ait parlé. Rien que ce silence me fait froid dans le dos.
2Le comité d’éthique belge a voulu donner un garde fou à la pratique en exigeant que le couple parent ait un projet parental en plus du projet thérapeutique. Mais cela ne résout en rien le problème. La question du « pourquoi est-ce que c’est moi qui vis ? » n’a comme réponse qu’un « parce que c’est toi qui pouvais guérir ton frère, ta sœur... »